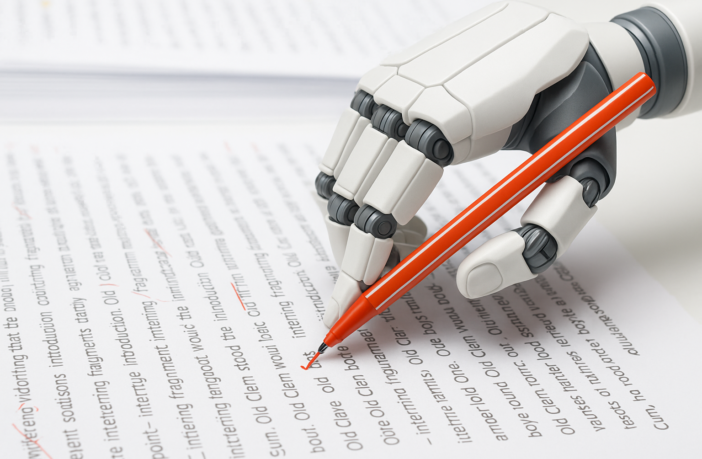Alors que l’intelligence artificielle s’invite dans les salles de classe, certains enseignants explorent son potentiel pour gagner du temps dans la correction des copies. Les positions restent toutefois mitigées : entre promesses d’efficacité et analyses personnalisées, se pose la question cruciale de la protection des données et du cadre institutionnel.
Ed.ai, Examino, Gingo, PyxiScience… Les outils proposant une assistance IA à la correction de copies se multiplient. Bien qu’elle ne soit pas encore massive dans le monde de l’éducation, cette pratique commence à se répandre chez les enseignants.
Un gain de temps important
Mélanie Fourreau, enseignante de SVT au collège Assomption Orléans, a opté pour Logbook. Lancée à la rentrée 2024, cette EdTech est encore en phase d’accrochage au GAR. Elle permet aux professeurs de partager avec leurs élèves des commentaires oraux afin de gagner du temps. « Étant submergée par les copies – j’ai 12 classes au total – j’étais à la recherche d’un outil pouvant me soulager. J’ai ainsi découvert Logbook à l’occasion d’une formation que j’ai suivie. L’application me permet de commenter mes copies en oralisant mes observations. Puisque je parle plus vite que je n’écris, j’en dis forcément plus à mes élèves », raconte-t-elle. De leur côté, les élèves ont accès à des commentaires oralisés plus personnalisés. Problème : ils ne s’impliquent pas toujours dans ce processus. « C’est la seule limite de l’outil : il faut que les professeurs encouragent leurs élèves à se rendre sur l’application pour écouter les commentaires », explique-t-elle. L’efficacité de l’outil dépend donc fortement de l’investissement de l’enseignant pour mobiliser sa classe. Enfin, l’IA lui fournit des analyses globales de classe — trois points forts et trois points faibles — qu’elle partage avec les élèves en classe.
Des risques à ne pas négliger
Si la pratique de Mélanie Fourreau reste minoritaire, c’est parce que l’usage de l’IA en éducation relève de la catégorie « haut risque » selon l’AI Act, la réglementation européenne entrée en vigueur en août 2024. Bien avant l’apparition de ce règlement, Claire Doz, enseignante de français en lycée, a testé l’IA pour corriger ses copies en anonymisant les données de ses élèves. « Mais je ne le referais pas aujourd’hui, dans les conditions actuelles. Pourtant, l’IA a des potentiels dans certaines pratiques d’évaluation propres à ma discipline : elle peut corriger une dictée et des erreurs de grammaire plus rapidement que moi, faire des quiz de connaissances intéressants, par exemple sur le mouvement baroque. En revanche, s’il s’agit d’évaluer des travaux d’écriture, notamment au lycée, avec deux ou trois copies doubles, je suis plus sceptique. Elle ne peut pas saisir finement ce qui relève de l’implicite, de l’ironie. Son utilité se limite donc à l’évaluation de la maîtrise de la langue », souligne-t-elle. D’autre part, chaque académie, chaque collectivité, voire chaque établissement, choisit les outils numériques mis à disposition dans le GAR. « Dans l’académie de Paris, où j’enseigne, il n’existe pas, à ma connaissance, d’outils mis à disposition des enseignants pour corriger des copies avec l’IA. C’est ce qui me gêne aujourd’hui. Le jour où nous aurons, dans le GAR, des outils dédiés à la correction et validés par le ministère, je n’hésiterai pas à les tester« , explique-t-elle.
Et ChatGPT dans tout ça ?
Claire Doz constate que ses collègues de travail plébiscitent de plus en plus ChatGPT pour corriger leurs copies. Une pratique qu’elle juge dangereuse étant donné qu’il s’agit d’un outil non-européen et que les professeurs ne distinguent pas toujours l’anonymisation réelle de la pseudo-anonymisation. « Par ailleurs, l’AI Act prévoit l’obligation d’informer les apprenants en cas de recours à l’IA pour corriger leurs travaux. Surtout, il ne nous appartient pas, en tant qu’enseignants, de prendre la décision d’évaluer avec l’IA tant que nous n’avons pas un mot d’ordre ou un cadre institutionnel », prévient-elle. Résultat : former les enseignants aux enjeux et limites de l’IA, en s’appuyant sur l’AI Act, les recommandations de l’UNESCO et le Cadre d’usage de l’IA en éducation publié par le ministère de l’Éducation, devient une nécessité absolue. « Il est urgent de sensibiliser les collègues à la vigilance et d’attendre que des outils académiques validés nous soient proposés », conclut-elle.